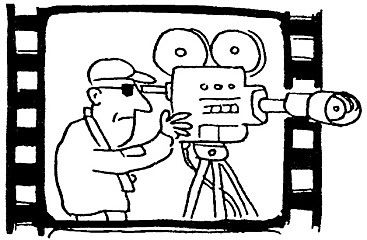La fosse septique Congolaise s’élargit et sa puanteur affecte toute l’Afrique

Récemment, peu d’informations proviennent de la région du Kivu en République démocratique du Congo. L’armée congolaise a subi de lourdes pertes ; le M23 occupe ou a libéré de vastes zones du Nord et du Sud-Kivu. On peut suivre les négociations en cours entre Rwandais et Congolais à Washington, ainsi que les discussions entre le M23 et le gouvernement congolais à Doha. Un observateur peu informé pourrait penser que des solutions sont en train de se dessiner pour mettre fin au conflit régional. Ce serait une bonne chose, mais la réalité est tout autre.
Il serait naïf de croire qu’une issue pacifique est envisageable avec les cartes actuellement en jeu. Le président Tshisekedi a atteint ses limites ; il ne peut que maintenir sa position ou faire semblant de le faire en allongeant le processus de négociation. Si cette stratégie tourne mal, il n’aura d’autre choix que de recourir à la guerre — une guerre qu’il perdrait probablement, ce qui pourrait l’amener à fuir le pays, laissant la place à d’autres politiciens congolais. Dans un pays où il est difficile de trouver des dirigeants honnêtes et compétents, placer ses espoirs en eux relève de l’utopie.
Comme je l’ai répété à maintes reprises, couvrir la RDC depuis plus de trente ans conduit inévitablement au cynisme. La majorité des faits sont évidents, mais peu de personnes semblent prêtes à les affronter ou à les résoudre. Début des années 1980, lors de mes premières couvertures, on me disait que l’État n’avait jamais été aussi fragile. Mobutu était encore au pouvoir, mais son emprise sur le pays s’érodait déjà. Sous les règnes des deux Kabila, la situation n’a fait qu’empirer, et aujourd’hui beaucoup affirment que la crise a atteint un nouveau sommet sous Tshisekedi. Comment en sommes-nous arrivés là ? Mon analyse repose sur mes propres investigations : j’ai échangé avec des dizaines d’acteurs en RDC ces derniers jours. Après près de six mois d’inactivité, j’ai eu du mal à me reconnecter à la réalité du terrain. Mon impatience et ma frustration ont grandi, notamment à cause du manque de moyens, de la méfiance, et du sentiment d’être contraint de taire certains sujets ou de ne rapporter que ce que l’on veut entendre.
Malgré tout, beaucoup de mes followers m’ont encouragé à reprendre la plume et la caméra.

Premiers éléments de constatation...
Comme je l’avais évoqué, il semble y avoir un peu d’espoir : le président américain Donald Trump affirme avoir facilité des négociations entre ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais, visant à établir une paix durable. Un second round de discussions est prévu en juin, et en juillet, Trump espère accueillir à Washington les présidents Kagame et Tshisekedi pour sceller définitivement la paix. Réussir à signer un accord de paix en RDC serait une petite victoire pour Trump, qui, avant son élection, se targuait de pouvoir arrêter rapidement la guerre en Ukraine ou à Gaza.
« Ce que Trump tente de faire n’est que du window dressing », confie un analyste congolais bien informé basé en Europe. « C’est le fruit de l’offensive de charme de Tshisekedi à Washington, destinée à obtenir un accès américain aux minerais du Congo en échange d’un soutien dans sa lutte contre le M23. Le président congolais a probablement saisi cette opportunité en constatant que les Américains utilisaient des arguments similaires pour soutenir l’Ukraine. À ce moment-là, il avait déjà perdu la majorité de ses alliés : l’Afrique du Sud se moquait de lui, les forces burundaises subissaient des défaites face au M23, la communauté est-africaine avait tiré des leçons, et l’Europe n’avait pas répondu aux attentes de Tshisekedi. Aujourd’hui, Rwanda et RDC travaillent sur un « accord de paix conditionnel » qui attirerait des investissements américains et permettrait à Rwanda de traiter et exporter les minerais congolais avant de les réimporter. Sur le papier, c’est une belle affaire, mais derrière se cachent plusieurs serpents venimeux : tout d’abord, le Rwanda n’est pas le principal acteur dans le conflit. Le M23 mène la majorité des combats, et il ne s’agit pas d’un mouvement rwandais à proprement parler. Le M23 est en train de mettre en place sa propre administration et ses forces de sécurité dans le Kivu. Au départ, ils ont commis plusieurs erreurs, et leur crédibilité a été mise à rude épreuve. Cependant, ils semblent désormais mieux organiser leurs troupes et maîtriser leurs collaborateurs, parfois corrompus. Une structure sécuritaire plus solide a été instaurée, et les responsables corrompus du M23 sont sanctionnés. Le groupe lutte désormais contre les éléments de Wazalendo et FDLR envoyés à Goma et Bukavu pour semer le chaos. La première exigence de Tshisekedi auprès des Américains était de convaincre le Rwanda de retirer le M23 de ses zones libérées et de rétablir une administration kinshasa. Or, cela ne sera pas possible, Trump ou pas. Le M23 ne quittera jamais ses territoires libérés, car ses combattants y voient une question d’honneur et de survie. Ils ont chassé l’armée congolaise et les extrémistes hutus pour protéger les Tutsis et permettre aux réfugiés Bagogwe de revenir dans leurs villages. D’autre part, la réputation de Trump dans cette région reste très douteuse. »

« Le gouvernement rwandais n’a rien à perdre en collaborant avec ce plan de paix américain », ajoute un autre observateur. « Mais ils savent pertinemment que cette démarche repose sur des bases fragiles. C’est la dernière chance pour Tshisekedi d’expulser le M23. La présence militaire rwandaise en RDC et son soutien au groupe rebelle sont souvent mal compris à l’étranger : les rapports des experts de l’ONU sont biaisés. Pour eux les Rwandais sont les seuls diables et comme ils ne parviennent pas à distinguer un guerrier M23 avec un soldat Rwandais ils gonflent les chiffres. La posture et les actions des politiciens européens anti-Rwanda sont influencées par des groupes extrémistes hutus, qui bénéficient d’un soutien ouvert à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes. La crise diplomatique entre la Belgique et Kigali illustre cette réalité, et il semble peu probable que cette situation évolue rapidement. La Belgique a perdu beaucoup de son influence à Washington, où les États-Unis ne la considèrent plus comme une source fiable d’informations sur la région des Grands Lacs. Si le Rwanda doit choisir entre abandonner le M23 ou satisfaire un président américain narcissique et instable, le choix sera évident. Le Rwanda a toujours préféré la négociation, mais a durci sa position lorsque Tshisekedi a commencé à instrumentaliser le FDLR pour provoquer une guerre ouverte. Les Américains, même Trump lui-même, comprennent probablement que le Rwanda est l’une des nations les plus stables d’Afrique, dotée d’une armée performante. Sans leur aval, la paix dans la région reste inaccessible. Si Tshisekedi refuse de négocier parce que le Rwanda ne lui ordonne pas de faire évacuer le M23, il se retrouvera isolé. Trump croit à tort qu’un accord unilatéral est possible, mais Kagame, fort de son expérience, a appris à se défendre, à l’image de Zelensky dans un autre contexte. »
Jusqu’à présent, peu de choses ont filtré des négociations à Doha, où le M23 rencontre une délégation de Kinshasa. Les participants se sont vu interdire de communiquer avec la presse, mais il est évident que les hôtes qataris deviennent nerveux face à l’attitude de Kinshasa, qui semble vouloir tout contrôler. Si ces négociations échouent, Tshisekedi aura épuisé son dernier espoir de conserver un semblant d’équilibre

La situation dans le Kivu...
La situation militaire dans la région du Kivu s’est quelque peu stabilisée. Avec la majorité des forces FARDC retirées du « Petit Nord » et d’une grande partie du Sud-Kivu, le M23 consolide désormais son contrôle sur ses zones libérées et les villes qu’il occupe. « On voit le Wazalendo se retourner contre l’armée congolaise dans certaines parties du Sud-Kivu », rapporte un observateur sur place. « D’autres se rendent au M23. Sultani Makenga et ses hommes profitent de cette accalmie pour redorer leur blason. La majorité des habitants de Goma et de Bukavu accueillent favorablement cette sécurisation accrue, la répression contre Wazalendo et FDLR infiltrés. Certains administrateurs du M23 font également du bon travail. Si cette tendance se confirme, il sera difficile de réintégrer la population dans la grande famille congolaise. Sur le plan économique, de nombreux ONG ont rapatrié leur personnel, ce qui a impacté l’emploi local. Espérons que cette problématique pourra être résolue. Par ailleurs, le groupe M23 a commencé à réduire les taxes exorbitantes qu’il imposait aux commerçants après la prise de Goma, et la fraude dans les bureaux fonciers diminue également. »
« L’influence du Burundi dans cette crise a aussi fortement diminué », précise un officier du M23. « Le général Neva hésite à faire franchir la frontière aux Imbonerakure, FDLR ou troupes régulières, de peur que nous ne les poursuivions jusque dans leur pays. Uvira reste une position stratégique clé – c’est la porte d’accès à Bujumbura. Des indications laissent penser que, si les négociations à Doha échouent, le M23 pourrait prendre Uvira. Jusqu’ici, Kigali a laissé Neva en paix, mais s’il continue à héberger des FDLR, il restera une source de nuisance. À mon avis, ses jours sont comptés, ainsi que ceux de sa femme influente et nymphomane. »

« L’Ouganda joue un double jeu hypocrite concernant la RDC », confie un ami ougandais que je croise à Kampala. « Leur objectif est de contrôler les régions riches en minerais et en pétrole à la frontière du Sud-Soudan et de la RDC. Ils sont déjà présents militairement dans une grande partie du ‘Grand Nord’ du Kivu, où se trouvent d’importantes réserves de pétrole autour du lac Édouard, ainsi que de l’or, du coltan et d’autres minerais. Pour justifier leur présence, ils cherchent à déstabiliser ces régions et à les maintenir dans la pauvreté. Beaucoup pensent que l’ADF-Nalu, groupe terroriste musulman, reçoit un soutien occulte de Kampala et de l’armée congolaise, ce qui leur permet de contrôler le commerce local des minerais. Le président Museveni confie cette gestion à son bras droit, le général Salim Saleh, et à son fils Muhoozi. En République du Sud-Soudan, ils fomentent aussi des conflits ethniques, notamment entre Dinka et Nuer. Pour l’Ouganda, tout cela sert à détourner l’attention internationale des véritables enjeux, et à dissimuler leur politique plus opaque dans l’est congolais. La critique mondiale contre le Rwanda et le M23 leur permet de masquer leurs activités plus sombres. »

Conclusion...
Avant que Donald Trump ne puisse brandir un accord de paix congolais comme un trophée de sa grandeur, il faudra laisser passer beaucoup d’eau sous le pont. La probabilité qu’il parvienne à concrétiser cela le 4 juillet à Washington, avec Tshisekedi et Kagame à ses côtés, semble faible. Je pourrais me tromper. Il n’existe pas de solution militaire dans cette région, et seule la négociation offre une issue. Même un accord de paix signé par Trump pourrait sauver de nombreuses vies, et rester une meilleure option que le statu quo.
La RDC n’est qu’un « side show » comparé aux conflits en Ukraine ou dans le monde arabe. Si Trump comprend que la paix en RDC ne lui rapportera pas de « coups » médiatiques, il pourrait tout arrêter. Miser uniquement sur Tshisekedi serait une erreur fatale. Si Trump veut vraiment résoudre les problèmes au Congo il sera obligé de prendre les revendications des M23 en considération aussi. La situation est complexe, et la suite reste incertaine.
À suivre...
Marc Hoogsteyns, Kivu Press Agency