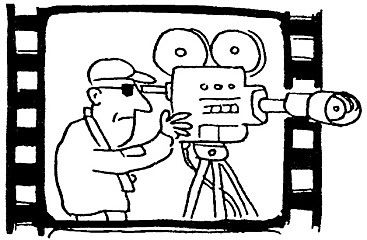Goma Blues : tous les regards sont tournés vers Kabila, entre contradictions, accusations et surtout beaucoup de clichés...

L’actualité dans les provinces du Kivu en RDC devient chaque jour plus difficile à suivre ; tous les yeux sont actuellement fixés sur les projets de Joseph Kabila, qui est arrivé la semaine dernière. Human Rights Watch a publié un rapport sur les violations des droits humains. La base dure des supporters du M23 commence à se demander si l’organisation ne passe pas à côté de ses objectifs initiaux — la libération de la région, l’arrêt des massacres de Tutsis et le retour des réfugiés dans leurs villages en RDC. Dans mon analyse précédente, j’avais écrit que Kabila bénéficiait encore de la confiance de nombreux locaux. Mais certains commencent à douter. Je remarque aussi que les responsables rwandais restent pour l’instant très évasifs lorsque je leur pose la question. Personne n’ose s’exprimer ouvertement sur tout ce qui se passe. Ils ont tous peur de mettre les pieds dans le plat ou de dire quelque chose qui pourrait leur revenir en boomerang.
Ce qui me frustre énormément, c’est aussi le fait de ne pas avoir les moyens financiers pour me rendre sur le terrain et constater la situation sur place. De la part de mes collègues journalistes, je ne reçois que des informations négatives : ils se plaignent amèrement du fait que de nombreux journalistes n’ont tout simplement pas accès à l’est du Congo. D’autres affirment que le M23 est très peu loquace et qu’il faut surtout s’adresser aux ONG locales, qui ont déjà peur de trop parler. Pour me faire une idée réelle de ce qui se passe, je dois désormais me reposer sur mon réseau d’informateurs avec lesquels je travaille depuis des années, et dont je peux évaluer la fiabilité.

Je vais citer quelques-uns d’entre eux, sans mentionner leurs noms. Écouter, voir et se taire : c’est ici la règle, et quand quelque chose se dit, c’est derrière des portes closes. Cela peut sembler peu crédible, mais c’est tout ce que je peux faire pour l’instant.
Situation à Goma
« La critique de Human Rights Watch (HRW) plane depuis plus longtemps », nous confie un observateur à Goma. « Ils s’appuient surtout sur des faits qui se sont produits il y a quelques mois, peu après la chute de Goma. À cette époque, le M23 était occupé à rassembler des armes que l’armée congolaise (FARDC) avait distribuées aux Wazalendo et aux FDLR, et qui étaient dissimulées partout en ville. Beaucoup de ces armes étaient encore utilisées pour des braquages et pour déstabiliser la ville. Au début, le M23 a essayé de faire le ménage à la hâte : des jeunes soupçonnés de faire partie de ces gangs ont été arrêtés. Quelques-uns ont été tués, mais en réalité, ils étaient bien moins nombreux que ce que l’on craignait initialement. Ce genre de maintien de l’ordre était aussi nouveau pour les rebelles, qui n’étaient pas encore habitués au travail de police. Par ailleurs, HRW n’est pas une source totalement objective : ils se basent principalement sur des informateurs de second ou troisième degré, membres de la société civile proches de l’administration précédente et qui ont aujourd’hui tout à perdre. Il est vrai que la nouvelle administration du M23 a connu plusieurs dérapages : des rumeurs circulaient sur des abus de pouvoir et des règlements de comptes, mais les dirigeants de l’organisation ont rapidement mis fin à ces excès. Ce qu’on peut reprocher au M23 aujourd’hui, c’est leur manque de personnel compétent dans l’administration. Ils ont besoin de temps pour corriger ces erreurs et pour mieux s’organiser. »

« Je suis en accord avec cette explication », ajoute un journaliste congolais. « Mais la faible popularité qu’avait encore le M23 à Goma s’est rapidement évaporée. La propagande anti-Rwanda et anti-M23, véhiculée depuis Kinshasa via les réseaux sociaux, a renforcé ce sentiment. À cette époque, Goma était toujours en crise économique, l’argent circulait très peu, et la population peinait à survivre. La situation s’améliore légèrement, mais il faudra encore beaucoup de temps avant que tout ne redevienne normal. Je peux confirmer que la sécurité en ville s’est améliorée ces dernières semaines. Ce n’est pas encore parfait, mais on voit que le M23 fournit des efforts pour s’attaquer à ce problème. La perception de la population reste profondément ancrée que des soldats rwandais seraient intégrés dans l’état-major du M23. C’est probablement une exagération, mais les Rwandais ne sont pas très populaires ici. »
« Ce qu’on peut affirmer avec une grande certitude, c’est que le M23 ne souhaite en aucun cas abandonner sa présence dans les deux provinces du Kivu », explique un chercheur étranger ayant récemment visité la région. « Ils imposent ainsi un fait accompli à la communauté internationale. En Europe, cela n’a pas encore bien été compris. Des pays comme la Belgique ont déjà tout donné pour essayer de freiner cette dynamique et ils ont cassé leurs dents. Ils insistent sur le fait que Tshisekedi, qui n’a jamais été élu par une procédure régulière, est le principal responsable de la situation actuelle. L’idée reçue selon laquelle le Rwanda serait derrière tout cela et que le M23 donnerait des ordres en coulisses pour faire avancer leur agenda, est fausse. Kigali n’était pas favorable, il y a quatre ans, à une nouvelle guerre dans l’Est du Congo. À l’époque, Kagame était surtout concentré sur le développement de son propre pays, la promotion du modèle rwandais en Afrique, et soutenir le M23 pour faire déstabiliser la région n’était pas à l’ordre du jour. Kigali a décidé de mettre des bâtons dans les roues de Tshisekedi lorsqu’il a commencé à réarmer la FDLR pour compenser la faiblesse de ses propres forces et infiltrer à nouveau le Rwanda. Cela a accéléré la crise. Le Congo d’il y a quatre ans n’existe plus. Le M23, ou les Rwandais, ne veulent pas balkaniser la région, mais la communauté internationale devra accepter que les Kivus ne seront plus jamais ce qu’ils étaient avant. Tant qu’on ne comprendra pas cela, les problèmes continueront de s’accumuler. »

Kabila
Un intellectuel rwandais-congolais, qui suit la situation de loin, constate que ce qui se passe actuellement à Goma met en lumière plusieurs vérités : « On peut dire que la constellation AFC-M23 est devenue un couteau à double tranchant. D’un côté, certains membres durs du M23 restent convaincus que la région autour de Goma doit être libérée des extrémistes Hutu, que l’administration alternative doit être mise en place pour permettre le retour des milliers de réfugiés au Rwanda et en Ouganda, et que le discours de haine contre les Tutsis congolais doit cesser. La cause principale du M23 se résume à cela. Au début de la rébellion, en 2022, personne n’espérait qu’ils pourraient aussi libérer le Sud-Kivu. Sur les plus de 200 000 Bagogwe Tutsis qui vivaient autrefois en RDC, à peine 20 000 ont pu rester, et ceux qui sont restés ont aussi été menacés en 2022. Le M23 n’avait donc pas d’autre choix que de reprendre la lutte. La gouvernance de Tshisekedi n’a jamais respecté les accords de 2013. Si ce dernier avait voulu négocier avec le M23 pour une solution pacifique, Goma et Bukavu n’auraient probablement jamais été attaquées. La suite, vous la connaissez déjà. Tshisekedi a force Sultani Makenga de lancer un ‘last stand’. »
« Kabila a été l’un des principaux responsables de ce conflit », poursuit l’observateur. « Il n’a jamais respecté les accords après la reddition de Laurent Nkunda, le commandant de Sultani Makenga. Il a continué à soutenir la FDLR, a été encore plus corrompu que son père, et a bafoué les accords avec Makenga lorsqu’il a pris Goma en 2013 (Kabila voulait tuer Makenga). Makenga s’est ensuite replié en Ouganda. Je pourrais donner beaucoup d’autres détails, mais ce serait un livre entier. Kabila a aussi réussi à dresser la majorité des Congolais contre lui, à cause de sa corruption et de sa gestion catastrophique. Fayulu a remporté la présidentielle suivante, mais il a été boycotté par la communauté internationale, qui craignait que le nouveau vainqueur ne provoque une réaction identique à celle d’un taureau face à une étoile rouge pour le Rwanda. Ainsi, Tshisekedi a pu faire main basse sur le pouvoir. Kabila a été maintenu en poste grâce à la promesse d’un changement de pouvoir futur et d’un siège de sénateur très bien rémunéré. Tout l’argent qu’il a volé en tant que président, il a pu le garder. Au début, Tshisekedi a aussi fait semblant de se rapprocher du Rwanda, mais au bout d’un moment, il est devenu évident qu’il voulait se débarrasser de Kabila et prendre le contrôle de tout. À partir de là, tout s’est dégradé. Tout cela a conduit Tshisekedi à se transformer en une sorte de deuxième Mobutu vorace, encore plus corrompu que son prédécesseur, mais sans la finesse politique du maréchal. Kabila s’est tenu en retrait durant cette période, mais il vient d’y mettre fin. »

Dans mon précédent article, j’avais déjà écrit que l’arrivée de Joseph Kabila à Goma était généralement accueillie favorablement par la population locale, qui voulait lui accorder le bénéfice du doute. Mais tout le monde n’est pas de cet avis. « Les objectifs initiaux du M23 sont totalement opposés à ceux de Kabila ou de Nangaa », poursuit notre informateur. « Le mariage antérieur entre le M23 et l’‘Alliance Fleuve Congo’ (AFC) n’a pas été très bien compris par leur base. Nangaa ne se souciait pas du bien-être des réfugiés tutsis congolais et de leurs villages. Le M23 voulait se libérer de l’étiquette rwandaise collée à leur mouvement par Kinshasa. Et au début, cela a fonctionné. Ceux qui posaient des questions à ce sujet entendaient qu’il s’agissait d’une décision stratégique, que le but principal de la rébellion restait le bien-être de la communauté tutsie congolaise. Mais la présence de Kabila à Goma met en lumière ces contradictions : il apparaît clairement que tout tourne surtout autour des intérêts de Kabila et Nangaa, tandis que la véritable préoccupation de la base du M23 est d’obtenir une région du Kivu plus stable, où les réfugiés revenus puissent être protégés et où leurs enfants puissent grandir en sécurité. L’organisation devrait également améliorer ses relations avec les Banyamulenges et se tenir à l’écart de Kinshasa. Car un Kabila qui a besoin d’eux aujourd’hui pour relancer sa carrière pourrait, demain, leur tourner le dos et se transformer une fois de plus en ennemi. Difficile de faire une analyse prospective aussi longtemps que Washington et Doha ne nous donnent rien, ce qui aiderait à mieux lire la présence de Kabila à Goma et comment il s’accommode au M23.»

Diplomate
J’ai aussi discuté de tout cela avec un diplomate belge ayant travaillé pendant des années dans la région et qui connaît bien ses interlocuteurs : « Je pense aussi que la Belgique a commis une grave erreur en adoptant une position si rigide et unilatérale vis-à-vis du Rwanda. La réalité d’aujourd’hui est totalement différente de celle d’il y a cinq ou dix ans. Mais si le M23 joue ce jeu intelligemment et reste fidèle à ses principes, il peut profiter de la présence de Kabila. Il serait cependant totalement erroné de se précipiter pour envahir davantage le Congo. Le M23 aura besoin d’un soutien politique international pour permettre le retour de tous ces réfugiés. Il doit aussi pouvoir se consolider sur le plan policier et administratif. Ce soutien ne pourra venir que si un régime à Kinshasa leur est favorable. Pendant que Fayulu, Kabila et Katumbi se disputent pour savoir qui sera le prochain président, le M23 peut en profiter pour mettre de l’ordre dans ses rangs et à l’intérieur du pays. Selon moi, le président Kagame ne sera pas idiot au point de se lancer dans une nouvelle aventure congolaise. Cela donnerait au M23 l’opportunité de se réconcilier avec d’autres groupes ethniques de la région, et la région pourrait profiter de la relance économique du Rwanda. Certains observateurs congolais à Bruxelles pensent que Kabila pourrait convaincre le M23 d’exercer une pression militaire supplémentaire à Kinshasa, mais je ne pense pas que cela soit une option réaliste. D’expérience, je sais que l’Europe et les États-Unis se désintéressent en réalité de qui est au pouvoir en RDC, tant que les minerais continuent d’être extraits. Mais une nouvelle guerre intérieure, comme celle qui a permis de chasser Mobutu, ne sera pas tolérée par les Américains et certains dirigeants européens. N’oubliez pas que papa Kabila a pu chasser Mobutu grâce à l’aide logistique des Américains. Cette fois ils ne vont pas le faire. Ce qui, en revanche, a déjà été accompli avec le retour de Kabila, c’est l’acceptation que ce conflit est désormais une affaire interne à la RDC. Et c’est déjà un bon début. »

Conclusion
Il est très difficile de se faire une idée objective de la situation sur le terrain. Certains collègues (et moi-même aussi) ne peuvent pas se permettre le luxe de rester plusieurs jours à Goma dans des hôtels chers, ni de louer des véhicules haut de gamme 4 x 4 pour explorer l’intérieur du pays. La guerre en RDC est aussi presque totalement « invisible » : logistiquement, il est souvent impossible d’atteindre les zones où se jouent les événements, et quand cela devient possible, toutes les parties font tout pour tenir la presse à distance. Cela se traduit souvent par des visites de presse inutiles, organisées par l’une ou l’autre partie, qui se soldent finalement par des déclarations du genre « la presse a été bien accueillie ». Je regrette aussi que, ces dernières semaines et mois, l’accès à Goma ait été refusé à plusieurs journalistes. Je trouve cela inacceptable, car j’ai moi-même vécu cela à plusieurs reprises : j’ai été persona non grata deux fois en RDC, et me montrer au Burundi serait un ‘one way ticket’ au cachot. Et pour être honnête je dois vous avouer que j’étais déjà au cachot là-bas deux fois. Ce n’est pas le Hilton ! C’est très difficile de ne pas froisser des sensibilités en couvrant ces pays. Mais exclure la presse ne fait qu’alimenter les clichés et la désinformation, surtout lorsque ce sont des collègues qui, au fond, veulent simplement effectuer leur travail. Ils pourraient eux aussi contribuer à corriger ces clichés. Un journaliste est aussi un être humain ; quand il rentre en Europe main vides il sera frustré et cela va se montrer dans ses futurs articles sur la région.
Beaucoup de personnes m’appellent pour connaître mon avis sur ce qui se passe à Goma. Je ne peux pas leur donner une réponse plus claire que celle que je formule ici. Mes excuses si cela semble insuffisant ! Le temps apportera des réponses. Un journaliste ne peut effectuer correctement son travail que s’il peut couvrir les faits sur place et s’immerger dans l’atmosphère de ces zones de conflit.
Marc Hoogsteyns, Kivu Press Agency